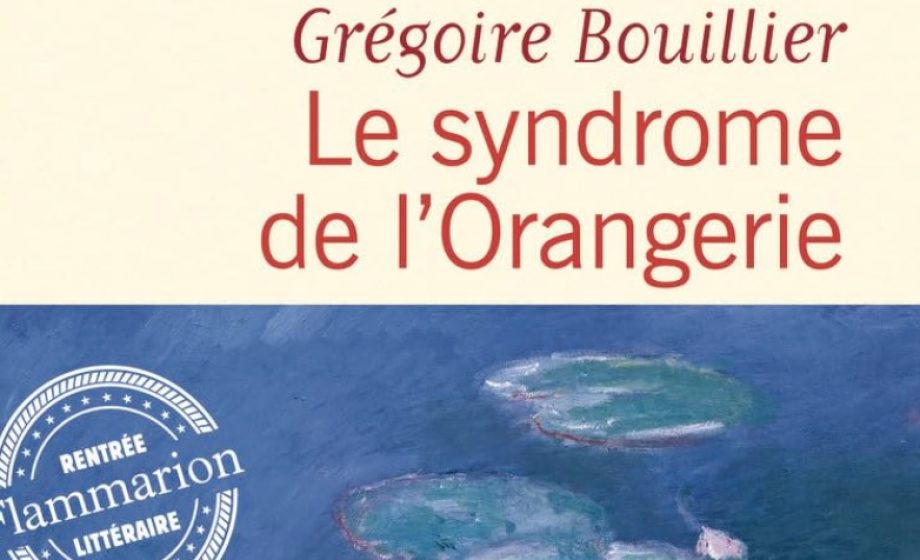Pour cette année consacrée aux impressionnistes, les éditions Flammarion proposent le dernier livre de Grégoire Bouillier, Le syndrome de l’Orangerie. L’auteur, ancien peintre mais écrivain depuis 2002, a déjà réalisé, selon ses termes, plusieurs « propositions littéraires » appréciées par la critique et couronnées de prix. Très soucieux de l’adéquation de la forme au contenu dont il rend compte, l’écrivain a, de plus, ouvert la voie, dès son premier roman Rapport sur moi (2002), à un nouveau genre : le rapport.
L’écrit de 2024, par la méthode d’investigation qui structure le récit, s’apparente à un rapport d’instruction. Cependant, cette enquête judiciaire a un objet très particulier, à savoir les cadavres ensevelis sous les Nymphéas de Claude Monet. Le rapport devient ainsi instructif. Les informations sur Monet et ses peintures, mais aussi sur tout ce qui peut aider, de près ou de loin, aux thèmes enchâssés de l’histoire, sont très documentées. Ce travail de fond est accompagné d’un souci d’écriture qui, malgré un déconcertant recours systématique au registre familier, ne semble pas non plus dépourvu d’ambition pédagogique.
L’intrigue commence par un dialogue surréaliste entre deux personnages d’une agence de détectives privés qui choisissent, dans un inventaire à la Prévert, quelle mort suspecte ils vont élucider. La décision sera prise au chapitre suivant quand le personnage principal ressentira un malaise devant la dernière œuvre de Monet et se persuadera que les panneaux de l’Orangerie recèlent un, voire plusieurs morts.
Il ne s’agit pas d’une exégèse des Nymphéas de Monet. Bouillier le précise. Cependant, la relation qu’entretient le peintre à ce qui est considéré comme son chef-d’œuvre est très approfondie. Dans les premiers chapitres, l’auteur, entraînant le lecteur avec lui, semble extraire, tel un enfant, des billes d’un sac en toile de jute. Chaque bille permet, sans en avoir l’air, une interprétation savante, compatible avec les connaissances accumulées sur Monet et avec l’hypothèse de lecture adoptée par l’enquêteur. Au rythme d’une pensée alerte et convaincante, les dépouilles possibles rejoignent une à une les Nymphéas dans l’atmosphère jubilatoire de la découverte. Cependant, progressivement la tonalité du discours s’assombrit, les chapitres s’allongent, le jeune investigateur cède le pas à l’adulte. Edgar Poe, avec ses ambiances macabres si bien connues de Monet, l’y aide. La visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, quasi simultanée à celle du jardin de Giverny, mêle les émotions du narrateur et invite l’auteur à en laisser des traces dans le style même. Les références aux deux sites s’entrelacent dans l’écriture. Le deuxième long chapitre évoque les épouses du peintre, et sa tonalité reste sombre. Il apparaît de plus en plus que la vie de Monet devient la projection investie du monde de l’auteur. Cependant, le pathos est toujours allégé. Les derniers chapitres raccourcissent, désorientant volontairement le lecteur qui s’attarderait trop sur les causes possibles du mal-être non plus du héros mais de l’écrivain.
Bouillier déroule une pensée en boucles. Intégrées à l’histoire, les digressions se multiplient. Elles peuvent alléger le propos principal en révélant des faits mineurs comme le prénom exact de la cuisinière de Monet. Elles peuvent aussi éclairer certains dires à travers de mini-anecdotes vécues par le détective dans un contexte différent. Lorsque les écarts ne servent pas le récit, ils relèvent de considérations plus générales. L’écrivain commente souvent les allégations de son personnage et donne son opinion sur le monde « national libéral » et ses dérives extrémistes. De même, Bouillier partage ses conceptions, plutôt critiques, sur la place de l’art dans le monde d’aujourd’hui. Il parle également de pratiques artistiques en spécialiste, interrogeant, grâce à Camille, première femme de Monet, le rôle du modèle ou proposant, au détour d’un passage, un véritable essai sur la série.
L’écrivain est aussi adepte d’un autre procédé littéraire : la parenthèse. Il profite de ces incises plus courtes que les boucles pour impliquer fréquemment son lecteur en l’interpellant directement ou en le rendant complice des commentaires adressés au héros. Ces incursions perlocutoires que l’on retrouve aussi parfois dans le corps du texte sont renforcées par des retours à la ligne inattendus et une typographie variée. Tous les moyens de l’édition sont mobilisés pour stimuler « le regardeur ».
Fond et forme s’entrecroisent. Le syndrome de l’Orangerie se lit comme un roman et s’apprécie comme un tableau. En optant pour une certaine homologie entre littérature et peinture, Bouillier, par sa narration et les procédés stylistiques qu’il met en œuvre, concrétise une conception de l’art dans laquelle l’artiste, sa production et le public forment un réseau d’interactions indissociables.
Un livre, émanation du temps encore présent, à découvrir absolument !
Grégoire Bouillier, Le syndrome de L’Orangerie, Flammarion, 2024, 432 pages.